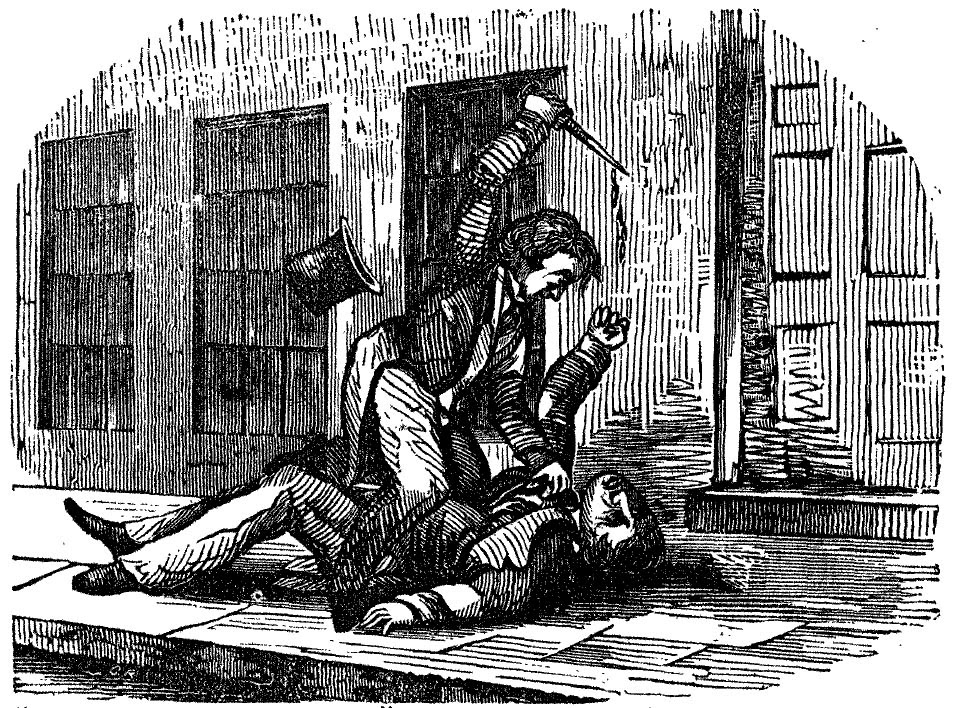Par le Lion Bleuflorophage
 Trésor public, banques, rappels de cotisations, carte postale, re-carte postale, trois lettres, j’achève la phase d’inventaire du courrier du matin, et ce faisant, j’en épuise la matière essentielle : l’élément de surprise. Celui-ci réside essentiellement dans ma propre attente de cette irruption quotidienne et imprévisible des objets et signes en provenance de l’extérieur, et jetés à grand bruit tous les matins sur le carrelage de l’entrée par la fente de la porte d’entrée.
Trésor public, banques, rappels de cotisations, carte postale, re-carte postale, trois lettres, j’achève la phase d’inventaire du courrier du matin, et ce faisant, j’en épuise la matière essentielle : l’élément de surprise. Celui-ci réside essentiellement dans ma propre attente de cette irruption quotidienne et imprévisible des objets et signes en provenance de l’extérieur, et jetés à grand bruit tous les matins sur le carrelage de l’entrée par la fente de la porte d’entrée.
Mais il y a malgré tout ces trois lettres encore intactes qui diffèrent un peu la consommation du rituel. Trois vraies lettres, c’est-à-dire, trois enveloppes blanches avec mon adresse et mon nom rédigés manuellement, et pourvues d’un timbre certainement collé à la langue. Il y a un univers entre les enveloppes administratives hostiles ou inhumaines, et celles-ci, qui depuis l’enfance, respirent le mystère et l’excitation d’une correspondance privée. Elles se font de plus en plus rares, et de plus en plus décevantes aussi. Fini l’univers inconnu de la page à conquérir, couverte d’une écriture au premier abord indéchiffrable à l’oeil enfantin trop récemment initié à la lecture. Terminée l’immersion dans le temps long, dense, compact, exotique, de la lecture des pensées d’autrui. La lettre amicale, pour l’adulte pressé que je suis devenue, est toujours trop brève, trop attendue, trop banale. « Il a fait un temps superbe tout le mois d’août ». Que m’importe. Je n’ai nul besoin de m’investir dans le fait d’y croire ou d’en douter. Rien ne bougera après lecture de cette phrase, rien de rien. Qu’elle ait été écrite ou non, cela revient au même, oubliée par l’auteur, et inexistante pour le lecteur. « J’ai écrit deux fois à ton ancienne adresse mais n’ayant obtenu aucune réponse, j’ai appris tes nouvelles coordonnées par Cécile qui m’a aussi donné de tes nouvelles ». J’avais en effet reçu ses deux lettres précédentes m’informant de son changement d’adresse et réclamant de mes nouvelles, mais que vouliez-vous que je réponde ? : « Ça va très bien » ou bien « ça ne va pas très bien », « Je t’écris pour te dire que je vais bientôt déménager, je te donnerai plus tard ma nouvelle adresse »…?
Et d’abord, que sont au fond ces fameuses « nouvelles » ? Toujours annoncées, toujours réclamées, elles s’évanouissent mystérieusement dès qu’on les invoque. Peut-être les invoque-t-on pour cela justement, pour les faire disparaître, les éliminer, leur régler leur compte, si bien qu’il n’en sera plus question : « je voulais avoir de tes nouvelles ». Le jour où j’ai pris cette demande au pied de la lettre, c’est mon correspondant qui s’est volatilisé ; je le croisai peu après, il parut ne pas me reconnaître et ne m’adressa plus jamais la parole. Le pouvoir de ces nouvelles est immense. Trop grand pour être réellement utilisable.
Stéréotypes qui permettent de gagner du temps et de contourner les nouvelles : « J’ai revu dernièrement Untel qui m’a parlé de toi » — ce qui me dispense donc et même me dissuade délibérément de le faire — « Comment vont les enfants ? » « Ton mari ? », « Ton travail ? » — autant de questions oubliées sitôt la lettre cachetée — « Tu excuseras mon écriture illisible », « mon retard », etc..
Deux des trois lettres manuscrites de ce matin — « Il a fait un temps superbe » et « J’ai écrit deux fois à ton ancienne adresse » — ont déjà rendu leur âme. Je regarde maintenant la troisième, avec une indulgence anticipée. Que pourrais-je en attendre qui ne soit excessif ? Éventuellement une rémission de cette nostalgie que m’ont inoculée les quelques véritables lettres que j’ai reçu dans ma vie.
Ce type de lettres se fait rare. Leur occurrence suit désormais une courbe descendante.
Dans mon enfance, chaque lettre contenait quelque chose d’unique : l’écriture était une voix muette qui parlait par les yeux dans le silence infiniment intime du tête-à-tête. Je me rappelle les lettres de ma sœur, de treize ans plus âgée que moi : lettres de quasi adulte, ayant le somptueux mystère de tout ce qui est très âgé, mais avec la gravité naïve et franche de quelqu’un d’assez jeune encore pour prendre au sérieux ma propre lecture enfantine. J’ai sept ans, elle en a vingt.
Après son mariage, elle m’écrit moins. J’ai des correspondantes anglaises : laborieux pensum que ces courriers didactiques.
Je me rappelle nettement le contenu d’une autre correspondance intensive et pourtant combien plus aride : les centaines de lettres envoyées lors de la recherche de mon premier emploi véritable. Dans ce cas, c’est l’extrême dissymétrie entre qui écrit et qui lit qui a donné son relief étonnant à ces courriers adressés à des inconnus. Chaque mot donnait lieu à d’infinies hésitations, à une implication sans précédent dans la parole, dans la foi en la puissance du verbe et des signes. Jusqu’aux formules de politesse — Dois-je mettre « veuillez accepter madame » ou bien « recevez madame » ? — qui, lorsqu’on les écrit pour la première fois, flamboient et claquent de toute l’énergie révélée du langage, canalisée dans le rituel absurde de la formule. Chaque matin, mon paquet de lettres dûment timbrées était soigneusement trié, et distribué dans les fentes de la boîte « Paris », « Province », « Étranger », le tout bien correctement fait de façon que le miracle de l’acheminement puisse alors prolonger logiquement toutes les opérations d’écriture et de préparation des envois.
Je repartais avec le sentiment d’un travail bien fait, de bout en bout maîtrisé et composé avec la conscience de la densité et de la signification potentielle de chacun des mots et des gestes mobilisés. De tout cela ne pouvait sortir que du bon, dans la logique même qui était celle d’un mécanisme, dont j’assumais une partie du fonctionnement au mieux de mes capacités.
La rareté et la banalité des réponses que je recevais en retour ne menaçaient jamais cette conviction que j’aurais dû réussir, « normalement » j’aurais dû réussir. Cela me permettait de considérer chaque refus comme un accident circonstanciel, exceptionnel, grâce à quoi je conservai pendant des mois le moral inattaquable de qui est bien parti et chemine sans entrave sur sa route.
La dernière lettre, posée sur la table, attend toujours. Je voulais raisonner et la dépouiller de son faux mystère avant de l’ouvrir, mais voilà qu’entre temps, je lui ai au contraire découvert à l’examen quelques particularités qui ont déclenché la curiosité brutale, vertigineuse, qu’éveille un autre type d’envoi encore plus rare que la lettre : le paquet inattendu. L’écriture reste inconnue, et pourtant elle m’appelle directement par mon prénom et mon nom. Facilité ou simplicité sans doute. Le papier est taché, et la surface est accidentée par de légers renflements irréguliers. Il y a quelque chose dedans.
Je déchire l’enveloppe, comme on déballerait un cadeau.
J’ouvre, il en tombe le carbone jaune, usagé, d’un formulaire administratif déchiré dans la partie inférieure, un carton gris de très petite taille qui doit être le petit côté d’une boite d’emballage, un morceau de sac en plastique blanc, deux feuilles de carnet à spirales. Ces matériaux sont numérotés de 1 à 5, et couverts d’une écriture plus ou moins lisible. Je remarque tout de suite que la partie inférieure du formulaire a été déchirée, on voit juste les lettres du début des phrases manquantes, dommage. Ca devait être le plus intéressant. La justification de la lettre était peut-être et même sans doute dans cette partie absente, auquel l’auteur a renoncé finalement. La lettre est aussi hétérogène que son support. La personne a commencé, interrompu, repris, à plusieurs moments différents d’une ascension, et d’un séjour en montagne, ce qui fait que la moitié de la place est occupée par des formules d’introduction, de conclusion momentanée, et de reprise « Voila, je suis assis sur une pierre en train de t’écrire, à côté de mes deux amis », « je reprends la lettre car j’ai finalement trouvé du papier, mais on ne revient jamais en arrière », « on m’interpelle, je dois y aller, je reprendrai plus tard ». Il a changé de stylo trois fois, et a parfois eu du mal à trouver un support suffisamment plan pour obtenir un résultat parfaitement lisible. Les deux feuilles de carnet ont été obtenues d’un instituteur qui les a pris en stop sur quelques kilomètres, ce qu’il me précise soigneusement en entamant la première d’entre elles, sacrifiant du même coup la majeure partie de la surface ainsi gagnée.
Que reste-t-il sur les quelques lignes de la lettre proprement dite ? Essentiellement un court paragraphe sur le fait qu’il voudrait bien me faire partager ce qu’il ressent dans cet endroit perdu de l’Ariège où le groupe des trois amis s’apprête à rendre visite à une communauté hippie très à l’écart. Le plastique blanc, froissé, prend la relève du carton et supporte un fragment de phrase effacé dont il n’émerge, en capitales nerveuses, qu’un mot désormais isolé, écrit plus gros que les autres, et auquel la perte irrémédiable de son contexte donne une comique mais poétique incongruité : « BABYLONE ». Sur les pages à carreaux, il énumère les éléments du lieu : la montagne, l’air pur, les petits oiseaux, l’herbe verte. Le procédé de cette description, est si outrageusement insuffisant, il évoque les clichés d’une nature si convenue, qu’il en acquiert la poignante dignité du meilleur aveu d’impuissance à rendre compte par les mots. C’est cet aveu d’impuissance qui traduit au mieux la magie de cet endroit là-bas, si beau, si unique, qu’il n’est pas supportable d’en jouir tout seul « j’aimerais tant que tu puisses en profiter ». Sur la page suivante, cette même phrase répétée devient un cri : « je voudrais tant que tu puisses en profiter », et l’écriture fébrile s’affole, fait état de graves difficultés rencontrées cette année, mais qu’il serait impossible d’expliquer. L’envie de partager devient aussi impérieuse qu’elle est impuissante, elle s’étend au-delà du moment, de la situation, de la joie ressentie ici et maintenant, pour secouer des souvenirs douloureux qui lui remontent dans les doigts jusque dans la lettre. « On m’interpelle, je dois y aller ». Mon correspondant veut échapper à cela, à cette souffrance, à cette lettre qui soudain le domine et l’arrache à l’instant heureux qu’il était en train de vivre. Il conclut : « Je suis si triste que tu ne puisses voir ça ». Sa tristesse soudain envahissante est finalement endiguée et même réinvestie dans ce pur moment de bonheur dont participe l’envie de partager.
Quant à moi, je suis si triste d’avoir déjà fini de lire. Si triste.
Cette lettre est La Lettre.
Elle me renvoie soudain à ce monde de tous les messages, les correspondances, et courriers électroniques, tout ce que nous envoyons et que nous recevons, le cliquetis des claviers, les stylos empruntés, les portables et les bouts de papier, les instants volés au boulot, chez soi, en vacances, cette frêle construction bricolée, incessante. Je pense à toi et je te le fais savoir, disent d’abord toutes les lettres et tous les messages non professionnels.
Quelqu’un, un ami qui ne l’est pas assez pour me faire part d’autre chose, m’écrit trois mots au milieu de l’Ariège pour me dire qu’il m’écrit, rien de plus.
Ce qui me fascine, c’est l’énergie déployée à cette fin. Je l’imagine sur son caillou montagnard en train de chercher du papier, de déchirer un emballage de biscuits, de se faire donner un carbone froissé au fond de la poche d’un de ses amis (ce doit être son nom, lequel m’est inconnu, qui figure à l’endroit du formulaire), de prélever un morceau de plastique sur un des sacs de provisions. Compte tenu de la difficulté si perceptible de toutes ces opérations, tout ce que tait nécessairement mon interlocuteur de ce qu’il lui a fallu ensuite effectuer pour que la lettre me parvienne, et qui était, dans les circonstances où il se trouvait, bien plus difficile encore que tout ce qui précédait — trouver une enveloppe, un timbre, une boite aux lettres, conserver les fragments et surmonter la tentation de les oublier ou de les détruire passé le moment et les circonstances de l’écriture — tout cela me fait apparaître cette lettre reçue ce matin comme une chose miraculée, mille fois menacée par ses faiblesses, fragile mais supportée par une solide intention, infiniment touchante.
Je suis touchée par le bel élan impulsif qui l’a suscitée, et qui s’est révélé suffisamment fort pour supporter d’être relayé par des contraintes multiples mais assumées. L’envie de partager a fait son chemin.
Partager quoi ? Juste l’envie de partager. Je suis émue mais pas tout à fait dupe de la désinvolture de l’auteur, qui écrit sur son plastique et ses carbones en comptant sur son lecteur pour excuser la présentation désastreuse et même la charger de significations, ce que je m’empresse effectivement de faire. Je devine la mise en scène légèrement héroïsée de toute l’affaire, à travers les allusions répétées au fait qu’il quitte, qu’il reprend. A travers aussi le mystère de la partie prélevée, en bas de page, à la dernière minute visiblement : le non-dit mis en scène. Je l’imagine se réappropriant avec délices le spectacle de soi-même aux prises avec une impulsion généreuse, aux prises avec ce merveilleux « coûte que coûte » qui l’intègre encore mieux à la grandeur et la pureté du moment et du lieu, au milieu de la montagne sauvage.
Mais la part de ce qui ne peut être mis en scène, entre la fin de l’écriture et l’expédition, reste encore si importante, et suppose tant d’efforts invisibles, et tant de maturation depuis l’impulsion initiale jusqu’à la volonté soutenue d’expédier malgré tout, que mon correspondant est mille fois racheté de cette possible vanité qui a été la sienne, vanité innocente cependant, et même confiante, puisqu’il a sollicité et honoré à l’extrême ma capacité d’être un bon public.
C’est pourquoi je suis touchée encore une fois par la lettre, touchée d’abord et touchée ensuite. C’est pourquoi également je fais pour elle ce que je ne ferais pour aucune autre : je la déchire, et je la détruis, avec un serrement de cœur, car je m’interdis toute possibilité d’y revenir, de la relire, de la conserver, de la toucher, mais avec le sentiment très clair que c’est ce qu’elle appelle, ce qu’elle exige, pour rester à tout jamais ce qu’elle a cherché à être : un choc, dont les échos doivent désormais se développer sans elle, et ne concernent plus que moi, de la même manière que l’écriture proprement dite a été un moment qui l’a essentiellement concerné lui, mon correspondant. Ainsi débarrassée de tout ce qu’elle avait de dérisoire, d’insuffisant, de décevant a posteriori, la lettre devient ce qu’il a m’a délégué la tâche de la faire devenir : un dispositif pour honorer son lecteur, puisqu’il exige de lui réellement le maximum que ce lecteur puisse fournir.